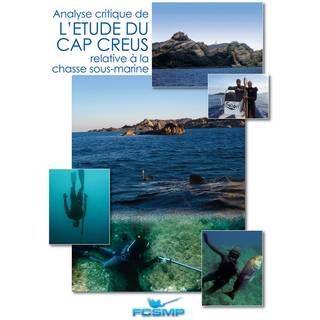Votre panier est actuellement vide !
Blog
06/08/11 : Actualités de la charte
 Les News de la Charte d’EngagementLes réunions se sont enchainées au cours de ce printemps 2011.Comme nous pouvions le prévoir, les discussions avec la DPMA et les pêcheurs professionnels se sont avèrées tendues et les consensus difficiles à trouver…
Les News de la Charte d’EngagementLes réunions se sont enchainées au cours de ce printemps 2011.Comme nous pouvions le prévoir, les discussions avec la DPMA et les pêcheurs professionnels se sont avèrées tendues et les consensus difficiles à trouver…Groupe de travail « Gestion de la Ressource »
Réunion du 06/04/2011:
L’ordre du jour de la réunion suit scrupuleusement les points de l’article 1 de la charte d’engagement:
– Tailles minimales
Les représentants de la pêche loisir proposent qu’une réévaluation à la hausse des tailles minimum de capture fasse l’objet d’un arrêté spécifique (auquel les professionnels seraient invités à se référer aussi afin d’optimiser l’efficacité de la mesure).
La réhausse de la taille aurait ainsi une double fonction :
- . diminuer le nombre de captures (pour exemple en ce qui concerne le bar, environ 30% des prises font entre 36 et 42 cm)
- . permettre au poisson de se reproduire avant d’être éventuellement pêché.
Un tel projet de modification peut être considéré comme une étape importante dans le sens de la protection de la ressource sans être une fin en soi. Cependant s’il sagit bien là d’un premier pas, il est vain d’espérer un quelconque impact sur la ressource, tant que ces dispositions ne seront pas également applicables à la pêche professionnelle. »
Lors de la prochaine réunion du groupe de travail, les fédérations de pêcheurs de loisir formuleront une proposition de modification des tailles légales de prises des poissons, de coquillages et de crustacés en cohérence avec la taille biologique.
– Ajouter ou retirer des espèces de la liste des espèces déclarées menacées.
La discussion s’est essentiellement portée sur les critères à adopter et les cautions scientifiques nécessaires pour modifier cette liste.
Au delà de la liste établie des espèces faisant l’objet d’un plan européen de reconstitution, certaines espèces peuvent être considérées comme menacées et faire l’objet de mesures locales ou régionales.
L’avis d’expert IFREMER mais également CIEM (organisme de recherche européen sur la mer) doivent être pris en compte.Le cas du corb (Sciaena umbra) en méditerranée a été évoqué. Cette espèce présente en annexe 3 de la convention de Berne, fait actuellement l’objet d’une démarche de moratoire à l’initiative du GEM (groupement d’étude sur le mérou).
Il est convenu que le groupe de travail « gestion de la ressource » a toute compétence quant aux mesures à prendre pour la gestion de cette espèce.– Période de repos biologique pour les différentes espèces.
Le sujet a fait débat entre les divers protagonistes sans qu’une perspective de décision ne soit évoquée:
Le représentant du CNPMEM demande qu’une expertise soit demandée à l’IFREMER sur l’intérêt de l’instauration d’un repos biologique espèce par espèce.
Les représentants de la pêche loisir font valloir que l’instauration d’un repos biologique pour la seule pêche de loisir ne présenterait aucun intérêt
La représentante de l’AAMP indique qu’il faut protéger en priorité les frayères et les nourriceries et réglementer les activités dans les zones qui les concernent.
Enfin la DPAM indique qu’une mesure d’arrêt temporaire (pêche pro) ne peut être qu’adossée à la perspective d’élaboration d’un plan de gestion, ce qui n’est pas le cas du bar.
– Limitation des prises journalières pour certaines espèces.
Les cinq fédérations de pêche loisir récusent une approche globale du problème, le texte du décret de 1990 visant formellement, avec la notion de table familiale, une interdiction de la revente des prises. Elles s’opposent à la volonté affichée par le wwf, la DPMA et l’ANEL de quantifier par un quota global les prises effectuées en pêche de loisir.
La représentante de la DEB indique que la question des quotas ne se pose que pour les espèces qui le nécessitent (ex : thon rouge, cabillaud ….) et propose une approche à partir de la ressource qui permettrait de lister les espèces en difficulté biologique, ou sur lesquelles la pêche de loisir a un impact significatif, plutôt que de partir de la notion de table table familiale.
Il pourrait être établi une liste des espèces particulièrement concernées, sur lesquelles seraient utilisés les outils de gestion les plus adaptés à l’aide d’un plan de gestion.
Il est indiqué que la pêche de loisir concerne à 95 % le bar, la daurade, le maquereau et le lieu.
Glossaire:
DPMA: Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
DAM: Direction des Affaires Maritimes
CNPMEM: Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
DEB: Direction de l’eau et de la biodiversité
CSNPSN: Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
ANEL: Association Nationale des Elus du Littoral
AAMP: Agence des Aires Marines Protégées
ONG: Organisations Non Gouvernementales
IFREMER: Institut français de recherche pour l’exploitation de la merRéunion du 15/06/2011:
Au cours de cette réunion, à laquelle étaient invités deux représentants de l’IFREMER et de l’ONG France Nature Environnement, devaient être repris à l’ordre du jour, les trois points tailles minimales, repos biologique, limitation des prises journalières pour certaines espèces, avec l’espoir de dégager des compromis entre les différents partis.
Les discussions ont tourné court. DPMA et pêche professionnelle, remettant en cause l’intérêt du repos biologique et mettant en avant les nombreuses contraintes auxquelles est déjà soumise la profession (engins de pêche, tailles minimales, quotas, réduction de puissance… ), refusent pour l’instant de consentir de nouveaux efforts sur quelque plan que ce se soit….
Face à ce blocage, les représentants de la pêche loisir maintiennent leur souhait de modification des tailles minimales de capture, mais ne consentiront aucune autre mesure restrictive tant qu’un geste effectif ne sera pas réalisé du côté des professionnels.

La DPMA et la DEB nous proposeront un projet d’arrêté dont la publication au JO ne s’effectuera qu’après l’accord formalisé de toutes les fédérations.
Revue de presse :
2011-08-02 LE_PECHEUR_DE_FRANCE : Vers une réforme des tailles minimales de capture…
2011-08-02 LOUP&BAR : Les tailles à respecter…
2011-07-22 LE_MARIN : Les plaisanciers proposent d’augmenter les tailles minimales de capture…
Groupe de travail « Déclaration de Pêche «
Réunion du 28/04/2011:
Suite aux réunions qui se sont tenues les 9 février et 24 mars 2011, cette réunion avait pour objectif technique de lister les fonctionnalités du portail de déclaration.
Deux points principaux ont été abordés: Le caractère obligatoire de la déclaration et les remontées d’informations en provenance des pêcheurs.
La déclaration constituant un « régime d’autorisation», elle ne peut être créée que par un décret en Conseil d’État. L’adoption de celui-ci nécessitant un délai, il est convenu que le portail pourrait être ouvert avant l’été, conformément au souhait exprimé par la ministre, avec une déclaration facultative pour une période expérimentale. Cela permettrait d’évaluer et améliorer la fonctionnalité de l’outil d’une part et d’autre part laisserait le temps à la DPMA de produire les propositions de textes la rendant obligatoire (2012).
Il est décidé par ailleur que le site comportera des onglets différents pour traiter des sujets différents :
– la déclaration annuelle d’activité,
– la réglementation applicable et les bonnes pratiques (base réglementaire de la DPMA)
– les fiches d’observations (ou « de sorties »)
Les pêcheurs saisiront, de manière facultative, les observations résultant de leurs activités, dans un onglet « fiches de sorties », distinct de l’onglet consacré à la déclaration. Cela nécessite que le système génère un identifiant pour chaque pêcheur.
La réunion du prochain comité de pilotage valider ces éléments.
Comité de pilotage
Réunion du 25/05/2011:
Point d’étape sur les travaux des trois groupes de travail.
Groupe de travail sur la lutte contre le braconnage :
La DPMA met tout le monde devant le fait accompli: l’arrêtémarquage est cours de validation au JO, et ce, sans validation préalable des membres du Copil. La méthode mais également la présence du maquereau (qui avait déjà suscité des débats animés) dans la liste des espèces concernées par la mesure sont réprouvées par les représentants de la pêche loisir. ceux-ci trouvent en la personne du député Boënnec (ANEL) un allié de poids: Ce dernier s’inquiète d’une incompréhension probable de cette mesure et indique que la question de la présence du maquereau dans la liste des espèces qui doivent être marquées, pourrait être portée et remise en cause au niveau politique.

Télécharger l’affiche d’information marquage Groupe de travail sur la déclaration de pêche de loisir :
La DEB nous informe que le développement du site se fera aussi en deux phases:
– les éléments d’information et de déclaration annuelle seront mis en ligne en priorité dans des onglets dédiés visuellement identifiables;
– les éléments relevant du recueil d’information plus détaillé (fiche de sorties) seront mis en ligne plus tard.Les fonctions seront en l’occurrence :
– la déclaration individuelle de pratique(obligatoire);
– l’accès aux pages d’information réglementaire (obligatoire) et de bonnes pratiques (facultatif);
– la déclaration annuelle de pêche (facultatif);
– la saisie de fiches de sorties (facultatif).L’administration souhaite que la première phase soit effective cet été dans une version d’évaluation facultative (voir cr du gt déclaration pêche) .
Les représentants de l’ANEL rappellent que l’ensemble des pratiquants n’a pas forecément d’accès à internet et proposent que des moyens de faire la déclaration soient mis à disposition des pêcheurs dans les offices de tourisme ou les mairies.
Groupe de travail sur la gestion de la ressource :
En toute fin de séance, il est rappelé que le 15 juin (voir page précédente) le gt devra traîter des sujets suivants:
– la définition de tailles minimales propres aux pêcheurs de loisir et la liste des espèces pouvant en faire partie
– la définition de celles pouvant faire l’objet d’une période de repos biologique.
Comité de suivi :
Au vu de la mise en oeuvre tardive du processus de concertation charte, rendez-vous est pris à l’automne plutôt qu’à la date initialement prévue début juillet.
27/05/11 : Arrêté marquage des prises

Le marquage de certaines captures est désormais obligatoire !
Avec la parution de l’arrêté du 17 mai 2011 au journal officiel, le marquage de certains produits de la pêche maritime de loisir devient obligatoire ! Cette mesure est accompagnée d’une note de service enjoignant les préfets de mettre le plus rapidement en place des conventions partenariales afin de renforcer la lutte contre le braconnage.
Ces premières mesures marquent le démarrage du chantier règlementaire qui accompagne la mise en oeuvre de la charte d’engagement.
La lutte contre le braconnage et la revente illicite des produits de la pêche de loisir était une priorité des institions administratives et professionnelles du milieu de la pêche. C’est donc dans ce sens que les deux premières mesures du chantier règlementaire de la charte se sont orientées.
En imposant une contrainte supplémentaire au plus grand nombre, le marquage obligatoire des prises sera celle qui fera le plus de bruit dans le milieu amateur, et ce d’autant plus qu’une majorité de pratiquants connaisseurs ne croient pas en son efficacité, la revente illicite existant surtout dans le milieu des particuliers…
La FCSMP, comme tous les représentants de la pêche loisir présents dans ce débat, a fait savoir ce point de vue à ses interlocuteurs sans toutefois en faire un point de blocage, les enjeux de la charte allant bien au delà de cette mesure.
Cependant, nous ne sommes pas pour autant restés spectateurs de l’élaboration de ce texte et avons su imposer nos idées pour le rendre le plus cohérent possible. Ainsi, mis à part le cas du maquereau qui n’a pas été résolu dans le sens espéré, seules les espèces présentant une valeur marchande sont concernées par cette mesure. Une action administrative et politique est en cours afin d’essayer d’inverser la situation sur le maquereau, deuxième espèce la plus pêchée en France mais sans valeur commerciale réelle.
Avec un peu de recul, le marquage de certaines prises représente somme toute, une contrainte mineure pour les pratiquants honnêtes et compliquera certainement la tâche des pêcheurs mercantiles et de leur acheteurs qui s’exposeront à des sanctions lourdes si les actes suivent sur le terrain. Actes, qui comme nous l’espérons, débuteront par la généralisation des conventions partenariales dont l’objectif premier sera d’organiser localement une lutte efficace contre le braconnage et la revente. Plus discrète et moins tapageuse, cette mesure est à nos yeux la clé de voute du projetet et nous en serons partie prenante !
Le 8 Juin le groupe de travail « gestion de la ressource » se réunira de nouveau pour une discussion autour des thèmes suivants : augmentation des tailles légales de prise, ajout ou retrait d’espèces de la liste des espèces déclarées menacées, période de repos biologique pour les différentes espèces, limitation des prises journalières pour certaines espèces. Négociations critiques à venir, donc, entre des parties dont les visions de la situation divergent « quelque peu » !
Malgré cela, certains éléments commencent déjà à se dessiner et l’on peut dès aujourd’hui annoncer que les prochaines mesures que nous verrons en vigueur d’ici la fin de l’été seront la mise en place du portail déclaratif et l’augmentation des tailles légales de captures récréatives (avec notamment le passage du bar à 42 cm).
L’arrêté:

Liste des espèces devant faire l’objet d’un marquage :

Schéma de l’ablation de la nageoire caudale :


Rencontre Directeur DDAM 06 du 30/03/2011
Suite à notre rencontre avec Monsieur SELLIER, directeur de la ddam 83, nous avons sollicité un entretien auprès de l’administrateur en charge de la mer et du littoral des Alpes-Maritimes afin d’évoqer les sujets liés à la gestion de nos pratiques
– règlementations et bonnes pratiques,
– déclinaison locale de la charte d’engagement,
– gestion concertée de la ressource et des usages,
– point Natura 2000 en mer sur le département.La délégation était composée de Pascal Mathieu, président FCSMP, de Mohamed Oualdi président de l’ASPTT Nice, club FNSPA personne morale FCSMP et de Frédéric Flora, représentant local de l’association.
Nous avons été reçus par Madame Roudaut Lafon, directeur adjoint des territoires et de la mer délégué à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes (ex-directeur des affaires maritimes du 06) de 14h30 à 16h40.
Les premiers contacts avec Mme l’administrateur sont à la hauteur de nos espérances : la discussion est franche et décontractée.Présentations
Une rapide présentation de notre association est faite à Mme Roudaut Lafon par Pascal Mathieu rappelant son rôle et son action (valorisation image de la pratique information et responsabilisation des pratiquants, représentation institutionnelle et défense de l’usage, protection environnement). Mohamed Oualdi complète cette introduction en rappelant le rôle important joué par les clubs de chasse sous-marine, la synergie du rapprochement entre la dimension militante de FCSMP et celle, formatrice des clubs, assurant un relais d’information complémentaire entre les pratiquants de tous horizons et l’administration. Madame Roudaut Lafon en profite pour nous présenter la plaquette d’information à l’attention des chasseurs sous-marins éditée par la DDTM 06 Affaires Maritimes du 06. La possibilité d’une collaboration est envisagée pour la prochaine édition !!
Au fil des échanges qui sont restés informels tout au long de l’entretien, les divers sujets que nous souhaitions évoquer ont été abordés de façon très spontanée.
Charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche de loisir maritime éco-responsable
Les échanges qui ont eu lieu sur le thème de la Charte d’engagement et son chantier règlementaire, ont permis de faire le tour des évolutions à venir pour la règlementation de la chasse sous-marine et de mettre en avant le fait que la chasse sous-marine soit enfin prise en compte comme un usage de pêche loisir comme les autres : déclaration gratuite et obligatoire de pratique pour tous, marquage des prises, gestion de la ressource …
Comme le suggère l’article 2 de la charte d’engagement, Mme Roudaut Lafon est favorable à la création d’un comité local pêche pro/plaisance (départemental ou interdépartemental 83 et 06) qui aurait pour but d’établir une concertation entre usagers et administration avant toute évolution réglementaire locale, qu’il s’agisse de gestion des usages ou de gestion de la ressource. Elle souligne qu’une telle concertation entre les différents acteurs ne pourrait qu’améliorer la compréhension des décisions et apaiser les tensions ou conflits d’usages qui peuvent accompagner les dossiers sensibles.
L’interdiction hivernale spécifique aux Alpes-Maritimes
La question de l’interdiction de chasse hivernale spécifique au 06 a naturellement découlé de ce sujet. Mme Roudaut Lafon a été très attentive aux nombreux arguments que nous avons su développer concernant cette interdiction :
– Sous couvert de préservation de la ressource, nous savons tous pertinemment que cette restriction ne résulte d’aucune réflexion sur l‘état de la ressource et ses besoins et ne répond non plus à aucune logique de gestion.
– Cette interdiction n’est pertinente en aucune manière : seul l’usage le moins impactant est concerné, la période définie ne correspond à rien du point de vue de la biologie des populations et des écosystèmes comme de celui de la pression exercée par la csm en hiver.
– D’un point de vue pratique de nombreux chasseur ne pouvant pratiquer les week-ends sont pénalisés, tout comme les bénévoles encadrants des clubs qui sont obligés de consacrer de façon systématique leur week-end à la formation.
– Sur le principe, cet arrêté stigmatise un usage par rapport aux autres et même les citoyens d’un département par rapport au reste du pays.
– Enfin, comme dit plus haut, la chasse sous-marine est aujourd’hui placée sur un pied d’égalité avec les autres types de pêche dans la plupart des réflexions en cours et soumise aux même problématiques de prélèvement. Si des aménagements spécifiques doivent avoir lieu, il semble logique que cela se fera dans un cadre concertatif.
Nous concluons donc, au regard de la logique de cohérence et de concertation qui prévaut aujourd’hui, associée à la prise en compte des futures évolutions règlementaires qui concerneront tous les usages de pêche récréative, que cet arrêté mérite plus aujourd’hui que jamais d’être remis en cause.
Madame Roudaut Lafon reconnait le bien fondé de ceux-ci. Elle nous explique que la décision ne relève pas de son autorité mais de celle du ministère en charge de la pêche . Elle nous propose donc que dans un premier temps, le thème soit à l’ordre du jour de la première réunion du futur « comité local pêche professionnelle / plaisance ». Avant l’hiver prochain, ses conclusions pourraient être transmises à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au ministère de l’agriculture et de la pêche.
Le braconnage
Les sujets sensibles étant au centre de la discussion, nous abordons les problématiques liées du braconnage et de la vente illicite des poissons issus de la pêche récréative. L’ensemble des interlocuteurs est d’accord sur le fait que ce type d’activités qui il faut le dire restent isolées, gangrènent nos usages et ternissent leur image, ils dégradent les relations avec les pêcheurs pros et doivent être combattus sévèrement. Le marquage obligatoire des prises « nobles » qui devrait être effectif avant l’été renforcera leur traçabilité.
En adéquation avec l’article 3 de la charte d’engagement, nous convenons qu’effectivement un renforcement des sanctions est nécessaire pour dissuader non seulement les braconniers mais également les recéleurs. Enfin l’établissement d’une convention partenariale comme il en existe déjà dans le département du 22 , entre les parties concernées, l’administration et le procureur de la république est une possibilité envisageable qui permettrait aux signataires de se porter partie civile et d’accélérer les procédures dans le traitement de ce type d’infraction. Autant de sujets qui valident l’intérêt de réunir notre futur « comité local pêche professionnelle / plaisance » !
Une date devrait donc être fixée très rapidement afin de rassembler les différents acteurs autour de la table et d’engager le processus de concertation.
Sécurité des chasseurs sous-marins
Comme lors de notre rencontre avec Monsieur Sellier Directeur de la DDTM 83 DDAM 83, nous avons réitéré nos revendications sur un sujet qui nous tient à cœur : la protection des chasseurs sous-marins par les bouées et pavillons réglementaires.
Mme Roudaut Lafon est consciente du problème et reconnait qu’il existe un réel danger. Elle nous fait savoir que la réglementation telle qu’elle est rédigée et appliquée en Atlantique, mer du Nord et Manche (lien arrêtés) ne peut être selon la Préfecture maritime transposée en l’état en Méditerranée.
Raisons invoquées : face à l’exigüité de la bande côtière fréquentée en Méditerranée, l’application de l’interdiction de naviguer à moins de 100 mètres d’une bouée arborant le pavillon CSM, rendrait de nombreux sites difficilement navigables pour les autres usagers, voir complètement embouteillés. De ce fait, le Préfet maritime de la zone méditerranéenne n’est peu enclin à valider une telle application.
Nous insistons pourtant sur la nécessité de définir quand même une zone de protection du chasseur sous-marin en action de pêche afin d’éviter tout drame, quitte alors à réduire la distance à 50 mètres. Mme Roudaut Lafon, en accord avec notre préoccupation nous propose de faire remonter notre demande auprès du Préfet maritime.Si cet arrêté particulier, même revu à la baisse en matière de sécurité, pouvait voir le jour, les forces de l’ordre auraient alors enfin un texte leur permettant de relever des infractions à la sécurité comme cela est déjà le cas pour les pratiquants chasseurs. Bien sûr, nous ne serions pas pour autant en un clin d’œil à l’abri des « chauffards des mers », mais l’on peut espérer que le monde la plaisance sera de fait sensibilisé à notre sécurité par la mise en application rapide des forces de l’ordre qui se trouvent pour l’instant démunies de textes réglementaires pour agir.
En attendant Mohamed Oualdi fait part de son intention de lancer une campagne d’information sous forme de tracts adressés aux plaisanciers selon divers réseau de diffusion, campagne pour laquelle il espère le soutien des affaires maritimes. Il est convenu qu’une fois réalisée, la maquette du projet soit transmise à Mme Roudaut Lafon.
Natura 2000
Le dernier thème abordé est celui de Natura 2000 en mer qui dans le 06 concerne 3 sites rassemblant la plupart des côtes rocheuses du département : sites du Cap Antibes, îles de Lérins site du Cap Ferrat et enfin site du Cap Martin (liens fiches N2000).
Madame Roudaut Lafon convient que le projet se développe dans le 06 lentement mais progressivement.
La discussion s’est plus attardée sur les aspects formels de mise en place que sur les sujets de fonds concernant les futures mesures de gestion qui peuvent inquiéter les usagers sur le maintien de leurs usages. Par expérience, nous connaissons maintenant assez bien le réseau Natura 2000 et les concertations qui l’accompagnent, et hors cas d’exception comme le site de Porquerolles géré par le Parc National de Port Cros, nous savons que la mise en place de ces aires marines protégées n’ont pas pour but de stigmatiser les usages, mais plutôt de faire évoluer les mentalités de ceux qui les pratiquent….
Actuellement on connait l’opérateur du premier site du Cap d’Antibes – mairie d’Antibes – qui a publié son calendrier de mise en œuvre de l’animation du docob : les réunion des groupes de travail débuteront normalement en avril . Un GT pêche pro/loisir auquel nous participerons est prévu.
En ce qui concerne le site de Cap Martin , Madame Roudaut Lafon nous confirme que la communauté d’agglomération de la Riviera Française seul postulant pour devenir opérateur du site sera désigné en tant que tel et démarrera bientôt la concertation.
Le site du Cap Ferrat n’a toujours pas trouvé de candidat et demeure, en attendant « preneur », en status quo !
Conclusion
La longueur étonnante de ce compte rendu témoigne de la richesse des échanges qui ont animé cette rencontre. Madame Roudaut Lafon a témoigné d’un réel intérêt pour notre pratique et la vision que nous nous en faisons. Elle a pris en compte avec sincérité nos préoccupations, nous permettant ainsi, d’émettre de sérieux espoirs pour l’avenir de notre passion dans le département sous son autorité.
Frédéric Flora / Mohamed Oualdi / Pascal Mathieu

31/10/10 : Commentaire critique de l’etude du Cap Creus
 Une des rares études disponibles sur la chasse sous-marine, celle du Cap Creus, fustige notre pratique et apporte un crédit inespéré aux gestionnaires peu scrupuleux qui souhaiteraient voir disparaître nos usages.Notre commission environnement s’est penchée sur cette étude et il va sans dire que nos conclusions critiques sont accablantes !
Une des rares études disponibles sur la chasse sous-marine, celle du Cap Creus, fustige notre pratique et apporte un crédit inespéré aux gestionnaires peu scrupuleux qui souhaiteraient voir disparaître nos usages.Notre commission environnement s’est penchée sur cette étude et il va sans dire que nos conclusions critiques sont accablantes !
Pour gonfler l’impact de la discipline, cette étude concentre grossièrement toutes sortes de subterfuges mâtinés tout à la fois d’un zest d’incompétence, d’une poignée de parti pris et d’une grande plâtrée de méconnaissance globale du milieu marin et de ses usages…La chasse sous-marine, pêche récréative la plus réglementée dans nombre d’Etats Européens, souffre de lacunes dans l’étude et la documentation de son impact sur le milieu naturel, laissant libre cours aux a priori et parti-pris à son encontre.
Dans le cadre de la généralisation de la mise en gestion des espaces marins littoraux (Aires Marines Protégées, Natura 2000, Parcs Nationaux, etc.), il importe de prendre en compte le plus justement possible les effets de cette pratique, sur la foi d’une bibliographie passablement maigre.
Ainsi, au cours de concertations d’usage du Parc des Calanques de Marseille, la FCSMP s’est vue opposer « un contexte scientifique défavorable » et un impact à hauteur de « 40% de la pêche professionnelle » (GIP com. pers., 2009), devant impliquer de grandes restrictions d’usage à l’égard des pêcheurs sous-marins.
Le gestionnaire nous renvoya d’un revers de toge vers une étude ayant eu lieu au Cap Creus, en Catalogne (Zaragoza et Al., 2007) !
Pourtant, une étude IFREMER sur la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) , espèce particulièrement convoitée des chasseurs sous-marins, semble bien au contraire montrer l’impact minime de la pêche sous-marine vis-à-vis des prélèvements des pêcheurs professionnels (IFREMER, 2005).
Très récemment, le Tome 1 du Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer (Agence des Aires Marines Protégées, 2009) présente le cas de la chasse sous-marine, et aborde un point de vue plus contrasté, voir bien moins défavorable à cette activité :
« […] la chasse sous-marine est une activité écologiquement viable car cette activité seule n’amène pas a une surexploitation des ressources pour la plupart des espèces, et car cette méthode de pêche est sélective, restreinte aux eaux de faible profondeur, n’induit pas de prises accessoires, n’utilise pas d’appât, ne cause pas de dommage sur les habitats, ne nuit pas aux espèces en danger, et ne produit pas de pollution » .
On relèvera cependant la mention de l’étude du Cap Creus dans la bibliographie, sans aucun doute liée à l’extrait suivant :
« Toutefois, plusieurs autres auteurs déclarent que la pêche sous-marine est un facteur important pouvant affecter la composition des communautés de poissons ciblés ».
Cette publication, reprise de toutes parts, et attestant, selon les auteurs et gestionnaires la prenant comme référence, d’un impact conséquent et problématique de l’activité de pêche sous-marine a attiré notre attention et a fait l’objet d’un commentaire critique par les spécialistes de notre Commission Environnement, commentaire dont les principales conclusions sont exposées dans la publication téléchargeable ci-jointe !Bonne Lecture !
Télecharger l’analyse critique FCSMP sur l’étude csm du cap Creus
Signature de la charte d’engagements pour une pêche de loisir éco-responsable
Pêche éco-responsable, ce n’est qu’un début !
Après deux années de gestation, la charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable a enfin été signée mercredi 7 juillet à Paris par les ministres JL. Borloo, B. Le Maire et les principaux acteurs du monde de la pêche et de la plaisance.
Pour FCSMP partie prenante de ce projet, Il s’agit bien là d’une étape fondamentale renforçant avant tout son engagement pour une défense efficace de la chasse sous-marine !
I. La signature
Après maints reports, dûs au difficile recoupement des agendas des ministres concernés, Messieurs Jean-Louis BORLOO (Ecologie et Développement Durable) et Bruno LE MAIRE (Agriculture Pêche et Alimentation), les signataires regroupant deux collèges d’acteurs, associatifs représentants des usagers et institutionnels, se sont enfin réunis mercredi 7 juillet 2010 au ministère de l’Ecologie pour signer la charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable. Ce texte né dans la mouvance du Grenelle de l’Environnement servira de cadre à l’évolution de la pêche en mer de loisir pour les deux ans à venir.

Les représentants des usagers
De gauche à droite : Jean-Louis Blanchard FFESSM, Jean Kiffer FNPPSF, Gérard Perrodi FFPM, Louis Herry UNAN et Pascal Mathieu FCSMP
(photo L. Scuiller)

Les représentants de l’état
De gauche à droite : Bruno Le Maire, ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, Jean-Louis Borloo, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et Loic Aballea de la DGALN.

Les représentants des institutionnels
De gauche à droite : Patrick Nayl ANEL, Daniel Lefèvre CNPMEM, Yves Colcombet Conservatoir Littoral, François Gauthiez AAMP et Gérard d’Aboville CSNPSN.

Pour Pascal Mathieu, ici en compagnie de Jean-Louis Borloo, le succès de cette charte est entre autre la reconnaissance de la chasse sous-marine comme un mode de prélèvement devant être géré selon les mêmes critères d’évaluation et modalités que les autres types de pêche.
Télécharger la version signée de la charte
II. Génèse de la Charte
Pour apprécier ce texte à sa juste valeur, il est primordial de connaître un peu son histoire !
En octobre 2007, le gouvernement lance le vaste chantier du Grenelle de l’environnement. De nombreux groupes de travail (33) réunissant représentants de l’état, des institutions, du monde professionel, du monde scientifique et des ONG – les COMOP – ont pour mission d’établir les cadres des décisions qui seront prises à long terme en matière d’environnement et de développement durable.
Dans ce processus, le COMOP 12 présidé par Jérôme Bignon, a pour tâche d’établir le plan de gestion intégrée mer-littoral dont la pêche loisir est bien sûr un des thèmes traités.
Initialement absente de la concertation et sentant la pression constante menée par le collège des ONG et de la pêche professionnelle qui souhaite la rapide mise en place d’un permis payant pour les pêches récréatives, la Confédération nationale de la plaisance et de la pêche en mer avec à sa tête Jean Kiffer (FNPPSF) et Louis Morvan (FFPM) manifeste son mécontentement auprès du Président de la république.
En mars 2008, avec le soutien du CSNPSN de Gérard D’Aboville, ils obtiennent leur intégration à la concertation en compagnie de la FFESSM alors présidée par Roland Blanc et de l’UNAN. La rédaction d’une charte pour une pêche maritime de loisir éco-responsable en alternative à la mise en place générale d’un permis payant est acceptée et le CSNPSN transmet début avril ses propositions au Comop 12.
Dans ses propositions, il apparait clairement que sous la houlette de Roland Blanc, la chasse sous-marine est traitée en bouc-émissaire, concentrant les restrictions d’usage de façon inconsidérée, provoquant les réactions et actions en chaîne de notre association :
Avril 2008 : Première analyse FCSMP
Octobre 2008 : Lobbying auprès des députés
Novembre 2008 : Courrier au président de la république co-signé avec Joel Bréchaire président de la commission pêche sous-marine de la FFESSM.
En début d’année 2009 suite à ces actions nous sommes invités à notre tour à venir exposer notre point de vue au ministère de l’écologie qui accepte de nous intégrer à la concertation et le remaniement du volet sous-marin de la charte selon nos conceptions.
L’idée de permis est écartée, l’accent sur la responsabilisation des pratiquants est mis en avant, la chasse sous-marine est traitée de façon équitable, mais cela ne plait pas aux ONG qui décident de quitter la concertation. Peu de temps après le CSNPSN est démis de ses fonctions de médiateur, le dossier passe dans les mains du ministère et la charte est une nouvelle fois remaniée dans sa version définitive, version dans laquelle la chasse sous-marine est considérée comme une pratique parmi les autres !
Suite à la démission de Roland Blanc, Jean-Louis Blanchard devient président de la FFESSM et adhère avec sa nouvelle équipe au projet aussi bien dans le fond que sur sa forme. La collaboration amorcée avec Joel Bréchaire sur ce dossier s’étend naturellement au CDN de la fédération.
Parallèlement, le chantier du Grenelle de la mer est amorcé en février 2009 et de nouveau, les représentants des usagers ne sont pas conviés aux tables rondes. ONG et Pêche professionnelle s’accordent une nouvelle fois pour demander le renforcement de l’encadrement de la pêche de loisir tels qu’ils l’ont toujours souhaité.
La contribution de FCSMP sur le site de consultation en ligne ainsi que celles de la FFESSM, de la FNPPSF et du CSNPSN font mouche et l’idée de permis est encore repoussée : Le livre Bleu des engagements du Grenelle de la Mer conserve la charte mais propose qu’une évaluation soit réalisée au bout de deux ans et que ses engagements (art. 26 et 27) soient cités en préambule de celle-ci.
La charte a été ébranlée mais n’a pas rompu. Les représentants des usagers impliqués et le CSNPSN se sont battus pour que celle-ci voit le jour, des concessions ont certes été réalisées et des consensus se sont imposés. La charte devra maintenant faire ses preuves dans les deux années à venir. Mais, de la bouche même de Jean-Louis Borloo, la mise en place d’un permis payant n’est pas aujourd’hui une solution satisfaisante pour favoriser l’évolution des mentalités et une meilleur gestion de la ressource.
Sa signature offre enfin l’opportunité d’une réflexion commune des acteurs concernés par la pêche loisir, elle permet la définition d’un cadre de gestion des usages qui pourra être décliné de façon cohérente sur les différentes façades maritimes dans le processus de développement des Aires marines Protégées.
III. Une charte, pourquoi, comment ?
Fruit des Grenelles successifs de l’Environnement et de la Mer, cette charte s’inscrit donc dans la volonté affichée par l’état, les ONG et les pêcheurs professionnels d’un encadrement rénové de la pêche loisir. Alternative à la mise en place d’un permis payant et mettant l’accent sur la responsabilisation des pratiquants, sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation dans deux ans (juillet 2012), conformément à l’engagement N°26 du Grenelle de la Mer.
Le texte s’articule autours de 5 objectifs résultant d’un consensus entre les trois collèges signataires (état, institutions, usagers) et sur lesquels l’engagement de chacun sera évalué :
- La mise en oeuvre de moyens accrus de lutte contre la vente illicite et le braconnage, moyens parmi lesquels le marquage des prises a été accepté par les représentants des usagers.
- La création d’un portail internet dédié à la pêche loisir qui permettra d’accueillir une déclaration obligatoire et gratuite pour l’ensemble des 2,5 millions de pêcheurs de loisir en mer
- Une reflexion pour la mise en place de mesures de gestion des ressources (mailles, quotas, repos biologique,etc…) adaptées et cohérentes.
- Afin de généraliser les pratiques responsables, le renforcement de l’information et de la sensibilisation des pratiquants, avec en corollaire une meilleure représentation des fédérations de pêcheurs plaisanciers auprès des pouvoirs publics.
- Le renforcement du dialogue entre administrations et représentants des usagers, engageant les parties à une pleine coopération avant chaque évolution réglementaire à l’échelle nationale et par façade maritime.
Très satisfaits d’avoir enfin franchi cette étape essentielle pour l’avenir des pêches récréatives, les signataires se sont tous accordés sur l’urgence à poursuivre cette démarche. De nombreuses réflexions seront engagées dans les prochains mois, suite à la création rapide d’un groupe de travail usagers et d’un secrétariat qui nous l’espérons sera de nouveau animé par le CSNPSN.
Ces réflexions porteront dans un premier temps sur les aspects règlementaires (marquage, déclaration de pratique), sur la répartition des tâches, ainsi que sur les moyens matériels dégagés pour la démarche (défraiement, financement des mesures et initiatives des signataires). A moyen et plus long terme, seront traités selon l’actualité les autres points de réflexion : dialogue, communication et gestion de la ressource.
IV. Conclusion et perspectives
Sans être un aboutissement, nous considérons que cette signature est pour nous, à plusieurs titres, une grande victoire et surtout une source d’espoir pour le futur de la chasse sous-marine :
- Les actions et réflexions que nous menons sans relâche depuis bientôt 8 ans sont enfins reconnus par les plus hautes instances décisionnaires et les acteurs du milieu de la pêche récréative.
- Suite à notre intervention, la chasse sous-marine n’apparait plus dans ce texte comme un usage stigmatisé.
- Ce texte a le mérite de réunir autour d’une même table tous les acteurs concernés par la gestion des pêches récréatives et nous félicitons d’en faire partie pour y défendre nos idées.
- Il a eu aussi le mérite de faire prendre conscience aux différents représentants de la pêche récréative que les problématiques des uns et des autres sont dans le fond les mêmes et qu’offrir un visage uni est la meilleure des réponses à apporter à nos détracteurs qui sont bien plus nombreux et puissants qu’on ne peut le penser.
- Nous possédons enfin un texte de référence sur lequel nous pourrons nous appuyer face aux gestionnaires de plus en plus zélés qui oeuvrent dans les concertations locales liées au développement des AMP.
- De la même façon, pour la première fois nous aurons notre mot à dire quant aux décisions de gestion des ressources comme par exemple la création ou la reconduction de moratoires.
Loin de tout triomphalisme, nous avons bien conscience que l’avenir des pêches récréatives, et qui plus est , de la chasse sous-marine, n’est pas pour autant joué. Mais aujourd’hui nous possédons un outil qui nous permettra de mieux le défendre.
Il nous appartient maintenant de tenir au mieux notre rôle dans ce processus, de mobiliser l’ensemble des partenaires potentiels et de fédérer les énergies.

13/11/08 – Synthèse sur la pêche au bar
Le bar commun ou loup (Dicentrarchus labrax – Linné 1758) est l’un des poissons emblématiques de nos côtes françaises. Du fait de sa forte valeur marchande et culinaire, il est un poisson des plus convoités tant par les pêcheurs récréatifs que professionnels.Qu’en est-il de l’état de ses ressources ?
Est-ce qu’une exploitation durable doit être envisagée pour préserver leur maintien ?Dans cet article, Philippe Gautier vous propose de faire le tour de la question et vous expose les positions de la FCSMP sur le sujet.Présentation générale
Le bar commun (Dicentrarchus labrax – Linné 1758) est l’un des poissons emblématiques de nos côtes françaises. En Méditerranée, il porte le nom de « loup ». Sa croissance est différente selon les régions et selon les sexes. Ainsi, à l’âge de 5 ans, la taille moyenne des femelles est de 54 cm en Méditerranée et 40 cm sur les côtes bretonnes, tandis que la taille moyenne des mâles est de 48 cm en Méditerranée et 39 cm sur les côtes bretonnes.Le bar est un poisson eurytherme et euryhalin, c’est-à-dire capable de supporter de grands écarts de température (de 2°C à 32°C) et de grandes variations de salinité (de 0,5 ‰ à 40 ‰). Il est possible de le rencontrer à peu près n’importe où : dans les estuaires, dans les baies, près des pointes rocheuses ou en pleine mer. Tous les hivers, les bars convergent habituellement vers des zones de frayères où ils se rassemblent en énormes concentrations pour se reproduire. Le reste de l’année, ils fréquentent les zones nourricières au bord des côtes.
Un poisson convoité par tous
Du fait de sa forte valeur marchande (le bar se classe à la troisième place en valeur des espèces commerciales en France), le bar est traditionnellement ciblé par certains pêcheurs professionnels côtiers (fileyeurs, palangriers et ligneurs). Les chalutiers s’intéressent de façon saisonnière à cette espèce qu’ils capturent lors des grands regroupements sur les frayères. Enfin, pour de nombreux pêcheurs récréatifs, le bar est considéré comme le poisson roi en raison de son statut de prédateur, de sa combativité et de la qualité de sa chair.
Une étude Ifremer réalisée en 2005 démontre un volume de prises comparable entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs récréatifs. Néanmoins, ces chiffres sont sujets à discussion en raison d’une grande incertitude sur la fiabilité des données recueillies ou estimées.
La pêche professionnelle
Les tonnages de débarquement ont fortement augmenté sur les 10 dernières années (surtout en Manche) et atteignent aujourd’hui environ 5 000 tonnes. La production du golfe de Gascogne est restée stable depuis 1986. Bien qu’elle soit toujours supérieure à celle de la Manche, les tonnages provenant des deux bassins sont actuellement du même ordre de grandeur.
Parmi tous les engins mis en oeuvre pour cibler le bar, certains sont utilisés plutôt en période hivernale (chaluts et filets), et d’autres plutôt en période estivale (lignes et palangres). Leur efficacité est très variable : celle des chaluts est très largement supérieure à celle des filets, qui est elle-même supérieure à celle des lignes et palangres. Les tonnages débarqués se répartissent environ ainsi : chalutiers (55%), fileyeurs (25%), ligneurs (15%).
Toutes les catégories jouent un rôle important car chaque type d‘engin est mis en oeuvre dans des zones et à des périodes de l’année différentes, ce qui implique un ciblage du bar permanent dans le temps et dans l’espace.
La pêche récréative
D’après l’enquête Ifremer de 2005, le nombre de pêcheurs récréatifs pêchant le bar est estimé à environ 900 000 personnes qui pratiquent cette activité essentiellement durant la période estivale. 50% des pêcheurs effectuent 5 sorties ou moins dans l’année, la moyenne se situant à 13 sorties.
Le total annuel des captures de bars s’élèverait entre 4 000 & 5 000 tonnes, réparties équitablement entre les trois façades littorales de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée. Les engins de capture utilisés sont la canne ou ligne (82 %) l’arbalète (9 %), le filet (7%) et la palangre (2%). La répartition en tonnage entre les différentes activités n’est pas connue.
Cependant, l’Ifremer reconnaît que tous ces chiffres sont à considérer avec prudence et demandent à être affinés par le biais d’enquêtes de terrains complémentaires qui permettraient de mieux détailler les pratiques des différentes catégories de pêcheurs récréatifs.Etat de la ressource
Dans son dernier avis publié en 2004, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) note que les stocks de bar de Manche, mer du Nord, côtes anglaises et golfe de Gascogne sont exploités à un niveau proche du rendement maximal par recrue, et à une taille moyenne de capture un peu faible, ce qui n’altère cependant pas la capacité de reproduction.
Le CIEM souligne aussi que le réchauffement des eaux en Manche et en mer du Nord crée depuis 1989 des conditions environnementales favorables à la croissance et au recrutement du bar. Dans ce même avis, le CIEM constate un probable accroissement de la mortalité due à la pêche, qui ne met pas encore la ressource en péril, et une expansion du stock, tant en taille et qu’en surface, due à des changements environnementaux. Les stocks sont donc considérés comme bons (la ressource bar n’est pas en danger) mais l’équilibre pourrait basculer rapidement si la pression de pêche augmentait d’une façon ou d’une autre.
Fin 2008, les ligneurs de Bretagne ont alerté d’une baisse très significative des prises de bars en 2008. La situation serait analogue en Manche et dans le golfe de Gascogne. Ils réclament aux scientifiques la mise en oeuvre d’une évaluation du stock « digne de ce nom » et que soient identifiés l’ensemble des paramètres affectant ce stock.
Pour une exploitation durable
Actuellement, il n’y a pas de réglementation européenne sous forme de limitation des prises de bar (pas de TAC, ni de quotas). Il existe cependant une taille minimale de capture fixée à 36 cm en Manche/Atlantique et 25 cm en Méditerranée. En France, les apports sont limités à 5 tonnes hebdomadaires par navire (arrêté du 16 janvier 2006).
Selon l’Ifremer, la limitation de l’effort de pêche ne peut être garantie sans moyen de contingentement efficace et contrôlé. Il est possible que dans les années à venir, le nombre de chalutiers ciblant le bar augmente compte tenu de la situation de la pêcherie d’anchois. L’interdiction totale de la pêche pendant le frai est une option de gestion de l’accès qui revient à interdire la pêche au bar à ces flottilles. À l’opposé, l’ouverture totale et sans restriction d’accès ne permet ni d’ajuster les capacités de capture à la production naturelle de la ressource, ni d’assurer le partage de la ressource entre usagers.
Les mesures de régulation pour une pêche durable du bar pourraient avoir pour objectif la répartition de la ressource entre les différents pêcheurs, y compris les pêcheurs plaisanciers. Par ailleurs, un groupe de travail du CIEM note le besoin de mieux connaître l’activité et les prélèvements de la pêche plaisancière compte tenu de son poids présupposé dans le prélèvement des bars : c’est même la catégorie qui aurait le plus gros impact. Une analyse des pratiques des différentes catégories de pêcheurs récréatifs permettrait de mieux cerner leurs effets sur la ressource.
Du côté des pêcheurs récréatifs, les pêcheurs à la ligne déclarent être favorables à l’application d’une maille « biologique » de 42 cm, pour être certains que les femelles se sont reproduites au moins une fois. L’idée d’un repos biologique pendant l’hiver est aussi évoquée. Globalement, les pêcheurs de loisir en mer interrogés dans l’enquête Ifremer apparaissent très largement favorables à la mise en place de périodes de repos biologiques (90%), à la limitation des prises par sortie (84%) et à un renforcement des contrôles (82%). Par contre, ils sont plus partagés quant à la mise en place d’un permis, que ce soit pour protéger uniquement certaines espèces (59%) ou pour protéger toutes les espèces (41%).
La connaissance de l’évolution des pêcheries montre que c’est lorsque l’état du stock est satisfaisant qu’il faut mettre en place de mesures de gestion et de contrôle de leur efficacité. Quand sa situation est trop dégradée, il devient en effet extrêmement difficile de rétablir une situation biologiquement saine et économiquement viable. Les exemples de la morue en mer du Nord et du thon rouge en méditerranée sont riches d’enseignements.
Position de la FCSMP
Consciente de la fragilité de la ressource « bar », la FCSMP est convaincue des nécessaires mesures de gestion à appliquer dès à présent pour garantir sa pérennité à terme. Pour cela, elle invite tous les pêcheurs sous-marins à respecter les préconisations suivantes :
1. Maille biologique
Respect de la maille biologique de 42 cm afin de laisser le temps au bar de se reproduire.
2. Période de frai
Constatant une dégradation sensible des prises en Manche et Atlantique, la FCSMP recommande aux pêcheurs sous-marins de ne pas prélever de bars sur ces deux façades durant cette période.
Concernant la Méditerranée où la ressource semble plus stable, le pêcheur sous-marin se doit d’être hyper sélectif en période de frai et limiter le dérangement des compagnes.
3. Nombres de prises
Le pêcheur sous-marin responsable prélève toujours dans le respect et jamais dans l’excès les poissons destinés à sa consommation familiale.
4. Impact et environnement
Afin de mieux évaluer l’impact de notre pratique et contribuer à la gestion de la ressource, la FCSMP encourage tous les pêcheurs sous-marins à participer aux études institutionnelles et à remplir un carnet de prélèvement en ligne sur le site www.fcsmpassion.com.
La FCSMP invite les pêcheurs sous-marins à rejoindre les structures gestionnaires des parcs marins et des zones Natura 2000 afin de participer localement aux travaux de réflexion et à la gestion des ressources.
Il va sans dire que pour être efficaces, de telles mesures n’auront d’impact réel que si elles s’appliquent à l’ensemble des pêcheurs récréatifs et si la pêche professionnelle adopte des mesures de gestion raisonnées.
Sources bibliographiques
Thèse « Traits biologiques et exploitation du bar commun dicentrarchus labrax (l.) dans les pêcheries françaises de la Manche et du golfe de Gascogne » (novembre 2005)
http://www.ifremer.fr/docelec/notice/2005/notice1088.htmAvis émanant de la CE sur l’état du bar dans les eaux européennes (mai 2002)
http://www.ifremer.fr/francais/produits/poisson/bar/acfm_bar.htmCommuniqué Ifremer « Zoom sur le bar, une espèce convoitée » (avril 2006)
http://www.ifremer.fr/com/communiques/11-04-06-bar.htmSite Web Collectif bar européen « Connaissance de la mer : le bar »
http://www.sosbar.org/Enquête relative à la pêche de loisir (récréative et sportive) en mer en Métropole et dans les DOM avec l’institut BVA (octobre 2007)
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossiers/littoral-peche-loisir/ifremer-se-penche-sur/downloadFile/FichierAttache_1_f0/Synthese_peche_de_loisir_091007-1.pdf?nocache=1195576858.8
http://peche.ffessm.fr/Environnement/Rapport_Enquete_peche_bar_2005.pdfEtude IFREMER « Point sur les travaux de recherche : Pêches récréatives et sportives en mer »
http://www.ifremer.fr/sth/docs/Ifremer_Peche_Recreative.pdfOFIMER : les chiffres clés de la filière pêche et aquaculture – édition 2008 (version française)
http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1723d1_01.pdfLigneurs de Bretagne : Coup de colère de décembre 2008
http://www.pointe-de-bretagne.fr/infos-actus.php?i=13